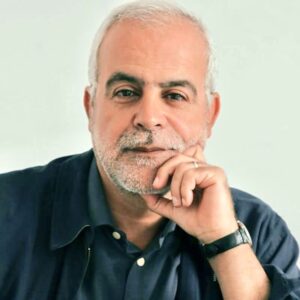Djamel Tatah expose son « théâtre du silence »
- Nadia Saou
- Publié le :
- 19h32
- Modifié le : 05/01/2023
- 19h40

Avec l’exposition de Djamel Tatah, à laquelle il réserve un très bel espace, le musée Fabre inaugure en grand sa programmation d’hiver. Cette exposition est impressionnante tant parce qu’elle touche la sensibilité du visiteur que parce qu’elle donne à ressentir la maîtrise savante du peintre. Avant l’exposition que la galerie Jerôme Poggi consacrera à Paris, en janvier, aux œuvres récentes de l’artiste, l’exposition de Montpellier permet de saisir l’esprit et l’unité profonde de l’œuvre de Tatah, des années 1990 à aujourd’hui : mêmes exigences et pureté chromatiques, personnages se détachant sur des fonds absolus au sens étymologique -détachés de tout lien, de toute référence-, scénographie qui met en tension les œuvres, tout concourt à un « théâtre du silence ». Il ne s’agit pas seulement de donner à voir le silence comme peut le faire le théâtre de Samuel Beckett mais surtout de montrer les suggestions du silence dans les œuvres comme dans les relations entre les œuvres. Ce que Djamel Tatah appelle une « exposition globale » se décline d’abord dans l’expérience de la couleur.
L’expérience de la couleur
L’usage de la couleur par Djamel Tatah a fait couler beaucoup d’encre : les historiens de l’art l’ont rapproché de mouvements comme le Colorfield. L’artiste s’y réfère comme il se réfère aux Nabis, à Matisse, à Picasso ou encore aux peintres de la Renaissance et notamment à Piero della Francesca : le regard du peintre est savant. Il faudrait ajouter ce qu’il a retenu des miniatures indiennes ou persanes. Mais ce qui compte, c’est sa manière de métaboliser les couleurs, leur construction expérimentale : aucune couleur ne préexiste, elle s’impose comme une intuition profonde quand la composition se met en place. Si les œuvres nous impressionnent, c’est parce qu’elles portent la trace du processus dans la texture même de la couleur. Loin que les fonds soient constitués d’aplats, la couleur vibre, construit et traverse l’espace et les êtres : qu’il s’agisse des premiers autoportraits, ceux intitulés Autoportrait à la Mansoura (1986), Autoportrait à la stèle (1990) ou des tableaux de dimensions plus imposantes comme Les Femmes d’Alger (1996), celui de 2004 avec la répétition de la figure du jeune garçon ou d’autres encore, la couleur se joue pour chaque œuvre dans une interaction entre la figure et l’espace. Une des intuitions artistiques les plus intéressantes de Djamel Tatah, très bien montrée dans le film de sa fille Saoussen Tatah, est l’usage de photos numériques pour positionner la figure, ses dimensions, ses proportions. Ce travail de placement dans l’espace de la toile -qui n’est pas sans évoquer celui d’un chorégraphe- dicte aussi les couleurs. Au spectateur de les interpréter ensuite selon sa sensibilité, ses attentes ou ses connaissances. Toutes les lectures qui prennent en compte la matérialité du tableau ont leur légitimité. Car autant que les fonds, les figures ont une lumière qui leur est propre et qui vient de leur placement : visions frontales, obliques, gisants, figures en suspens, Djamel Tatah se situe à l’opposé d’un peintre du décor, c’est la couleur même qui compose ses œuvres. Du coup si dans un petit nombre de cas, il y a une référence à des situations ou à des êtres réels, ceux-ci perdent leur valeur biographique : ses autoportraits ou d’autres peintures où l’on peut reconnaître ses proches, familles et amis, le prouvent, eux qui sont pris dans un jeu pictural à visée universelle.
Peinture « littérale mais pas littéraire »
Dès l’entrée de l’exposition, le visiteur est confronté à un triptyque comportant en son cœur la phrase de Camus extraite de Noces (1947): « Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le désir d’aimer sans mesure ». Certes on pourrait tirer de cette phrase une mythologie personnelle de l’Algérie. Mais les propos de l’artiste sont clairs à la fois en ce qui concerne l’inscription de la phrase dans le triptyque entre deux figures de jeune homme et en ce qui concerne la place de l’Algérie. S’il a avec le pays de ses parents une profonde relation affective, il n’a aucun message à délivrer : sa peinture -très rarement située par les titres de la première salle- est selon la formule de l’artiste « littérale mais pas littéraire ». La phrase de Camus témoigne d’une coïncidence ou d’une convergence de pensée sans que cela amorce pour le peintre le début d’un récit où la phrase ancrerait le sens de l’image. C’est uniquement par l’alchimie de la couleur, de la figure et du mouvement que se crée l’appel visuel qui fait la force des tableaux de Djamel Tatah. En témoignent entre autres les gravés et peints (2019) ou une toile de 2008 où les mouvements de personnages en suspens suscitent la surprise. Participent de cette esthétique du « choc », les œuvres déconcertent le spectateur, soit parce qu’il est exclu lorsque le regard du personnage est tourné vers un espace noir (Sans titre, 2022), soit parce qu’au contraire, le personnage est représenté en vision frontale : dans une œuvre de 2018, seule la moitié du visage du personnage féminin apparaît, ce qui renforce encore le sentiment de présence. Se rattachent aussi à cette esthétique la répétition des figures et les variations qui l’accompagnent : le regard est saisi par les ensembles de femmes, diptyque de 2005 ou triptyque de 1996, par la répétition des figures masculines dans deux œuvres de 2016, files d’hommes qui se croisent ou se tiennent face à face, la tête légèrement penchée. Les interprétations faites de la représentation de ces foules soulignent pour une bonne part d’entre elles l’incommunicabilité. Même si l’on peut partager ce point de vue, ce qui importe avant tout, c’est la manière dont d’une part, agissent les œuvres par la seule force visuelle qui s’en dégage et dont, d’autre part, le spectateur est impliqué dans ce théâtre du silence.
L’ombre de l’Algérie !
Pour autant ce ne sont pas seulement les œuvres auxquelles le visiteur est exposé, c’est à toute une mise en scène : le regardeur est confronté à différents rythmes qui ne sont pas sans rappeler ceux du cinéma : plan-séquence de l’entrée avec en son cœur le triptyque que nous avons évoqué, Autoportrait à la Mansoura, Autoportrait à la stèle ainsi que le gisant. Un même espace mental, les relations de l’artiste avec le pays à la fois physique et imaginaire qu’est l’Algérie reçoit différents éclairages. Un travelling partant des femmes d’Alger rythmé par trois monochromes finit par un gros plan sur un tableau qui introduit une rupture visuelle par son atmosphère bleu sombre de laquelle se détache la silhouette d’un gisant à peine éclairée par quelques traits donnant la structure. À l’entrecroisement avec les très grands formats des personnages en suspens, cette rupture permet une transition avec l’espace suivant où les œuvres ont en commun d’être fondées sur une structure répétitive. L’artiste agit aussi en cinéaste en créant des effets de profondeur de champ lorsque le tableau représentant un gisant sur un fond bleu (2007) est donné à voir depuis la dernière salle où est accrochée une œuvre récente (2022), de grand format, qui donne aussi à voir des gisants mais dans un espace que la couleur scinde en deux : celui sombre où les corps se devinent à travers quelques traits, et l’espace supérieur. Le regard instauré par la profondeur donne aussi à voir les personnages en suspens autrement qu’en vision frontale. Les tensions entre le mouvement et l’immobilité, entre les personnages statiques, hiératiques et les gisants, entre les figures solitaires et les foules, les rythmes donnés par les couleurs, suggèrent des sens autres que ceux qui se dégagent des tableaux eux-mêmes. Quand l’artiste parle d’« exposition globale », il pense à cette unité profonde entre les œuvres et leur scénographie, au travail ici indissociablement lié de peintre et de metteur en scène.
Top articles Culture
Les derniers articles
-
 PolitiqueRelations franco-algériennes : Retour sur le naufrage moral de la droite
PolitiqueRelations franco-algériennes : Retour sur le naufrage moral de la droite -
 SociétéJournée dédiée aux droits de l’Homme au Maghreb à la Bourse du travail de Paris
SociétéJournée dédiée aux droits de l’Homme au Maghreb à la Bourse du travail de Paris -
 HistoireLe 8 mai 1945 de la population européenne d’Algérie
HistoireLe 8 mai 1945 de la population européenne d’Algérie -
 HistoireMassacres du 8 mai 1945, l’autre crime colonial à reconnaître
HistoireMassacres du 8 mai 1945, l’autre crime colonial à reconnaître -
 HistoireLa France s’apprête à restituer les biens de l’émir Abdelkader à l’Algérie
HistoireLa France s’apprête à restituer les biens de l’émir Abdelkader à l’Algérie -
 Édito du mois8 mai 1945, à l’origine de la guerre d'Algérie
Édito du mois8 mai 1945, à l’origine de la guerre d'Algérie -
 CulturePourquoi il faut voir « La Couleur dans les mains » de Nora Hamdi ?
CulturePourquoi il faut voir « La Couleur dans les mains » de Nora Hamdi ? -
 CultureL’expo qui donne un visage méconnu de la « présence arabe » à Paris
CultureL’expo qui donne un visage méconnu de la « présence arabe » à Paris -
 Hôte du moisTassadit Yacine, la dernière papesse du « monde berbère »
Hôte du moisTassadit Yacine, la dernière papesse du « monde berbère » -
 TribuneReflux et recompositions de l’espace nord-africain
TribuneReflux et recompositions de l’espace nord-africain